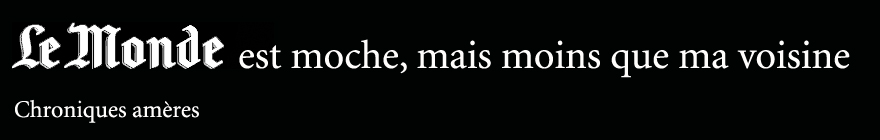Le mois de décembre est étouffant à Copa Cabana Beach Bay. Ici, je profite de la chaleur brûlante de l’été de l’hémisphère sud. Paresseusement allongé sur mon transat, j’émerge d’une sieste interminable en plein soleil. Combien de temps ai-je dormi ? Impossible à dire, parce que le soleil a fait perler une épaisse condensation sur le cadran de ma Festina de fabrication asiatique, pourtant présentée comme étanche. A en juger la position de l’astre, il doit être 15 heures. Je me serais donc assoupi trois bonnes heures. Sur mon torse extrêmement bronzé ruissellent des torrents de transpiration qui dévalent le long des sillons de mes abdominaux saillants, avant de s’échouer sur la cordelette de mon short en coton équitable.
Lorsque je lève les yeux, malgré les reflets aveuglants qui inondent la surface de l’eau, je devine derrière mes Ray Ban la silhouette sculpturale de Felindra. Nue comme un ver, elle sort délicatement de la piscine et se dirige vers le bar à cocktails, magistral ouvrage réalisé dans une essence de bambou local qui dégage un parfum boisé un peu trop pénétrant. Les seins pleins et gonflés de vie de la créature dansent la lambada au rythme de ses pas sur son torse cuivré et luisant. Les traces humides laissées sur les planches de la terrasse en teck s’évaporent aussitôt que ses pieds quittent le sol. Ce soleil frappe tellement fort que même l’ombre de son corps parfait dégouline de sueur. Lorsqu’elle se faufile à ma hauteur et croise mon regard, je détecte dans ses yeux tout le respect et la reconnaissance de celle qui peine encore à se remettre d’une nuit au cours de laquelle elle a exploré des territoires inconnus que ses cours d’anatomie avaient passés sous silence. Coquine. Et toujours ces effluves boisés de plus en plus présents.
Lorsque Felindra revient du bar, je m’extirpe difficilement du transat. La peau du dos, striée de marques rouges, fait un bruit de velcro quand elle se décolle du dossier en PVC blanc. Elle me tend un seau en inox Laurent Perrier, duquel elle sort un glaçon qu’elle promène le long de mes lèvres sèches pour m’humecter la bouche. Les souvenirs de la nuit précédente se précisent. Elle me présente ensuite un mojito servi dans un verre grand comme un lavabo, garni d’un petit parasol en papier et accompagne son geste de quelques charabias incompréhensibles, sans doute du Mandarin, prononcés avec un fort accent marseillais. « Mouyamé » que je me surprends à lui répondre. « Mouyamé, ma chérie. » Lorsque je goûte le breuvage pour me rafraîchir, je lui trouve un goût de pastis. Je repose les fesses sur la chaise longue, non sans avoir d’abord caressé les siennes, et m’allonge de nouveau, savourant le repos du guerrier en scrutant le ciel : pas un nuage, pas un centimètre carré d’ombre sur cette terre paradisiaque. Je me sens comme un calippo prisonnier de son plein gré d’un hammam à l'air libre. Je déguste. L’odeur de bois brûlé s’échappant du bar en bambou m’attaque les narines. J’en tombe à la renverse. Le téléphone sonne. "Allo ? Felindra ?" Personne. Le téléphone sonne toujours. Je bouscule le rocking chair, piétine la couverture qui reposait sur mes genoux flétris. Le parlophone. "Allo ? Felindra ? Qui ? Ah bonjour maman. Quoi ? Déjà ?" Et merde, ma dinde ! Et toujours cette odeur de brûlé...
Je hais Noël. Noël pas mouyamé.
vendredi 24 décembre 2010
Joyeux bordel
D'ici deux mois, je râlerai sans doute comme le reste de mes concitoyens, mais pour l'instant, j'aime bien la neige. Pas seulement pour la beauté douceâtre des paysages immaculés, qui évoque des odeurs de chocolat chaud et de cougnou, et permet au premier fonctionnaire venu de philosopher à moindres frais. Non. En fait, j'aime surtout la neige pour cette façon tranquille, poétique et implacable qu'elle a de foutre le bordel partout.
J'aime bien la neige, parce qu'elle n'épargne personne: un bordel à ce point intégral, il est tellement égalitaire qu'il en devient presque politique.
Quand toutes les routes sont bloquées ou verglassées, le gros manager vient au boulot en train, comme la petite stagiaire, et dans le train, il se bat pour un coin de banquette, comme tout le monde. Et s'il décide de sortir quand même la X5, bizarrement, il laisse traverser les piétons, respecte la priorité de droite et roule aussi lentement que la vieille Twingo derrière lui.
L'entreprise, elle, lutte à la fois contre une attaque terroriste et une grève générale: d'un côté, c'est plans d'urgence dans tous les sens pour assurer l'approvisionnement (quel qu'il soit) et faire tourner la boîte avec moitié moins de personnel, de l'autre, communications en tous genres pour convaincre les travailleurs que 30 cm de neige et 4 heures de bouchons, c'est pas une raison valable de pas venir au turbin.
Et malgré tout: les camions sont bloqués, y'a plus rien à acheter, les gens préfèrent rester chez eux. Résultat, la consommation baisse en pleine période de Noël.
J'aime bien la neige parce qu'elle réalise les cauchemars de ce monde de merde, sans fournir personne sur qui cogner à la police.
Tout tourne au ralenti, les avions sont cloués au sol, les bagnoles restent au garage, sans parler des trains et des camions. Les gens bossent moins (ou moins de gens bossent), et achètent moins. Ils passent du temps chez eux, et en plus les paysages sont jolis.
Finalement, la neige, c'est la nature qui fait de la désobéissance civile. C'est le monde qui se réenchante tout seul.
J'aime bien la neige, parce qu'elle n'épargne personne: un bordel à ce point intégral, il est tellement égalitaire qu'il en devient presque politique.
Quand toutes les routes sont bloquées ou verglassées, le gros manager vient au boulot en train, comme la petite stagiaire, et dans le train, il se bat pour un coin de banquette, comme tout le monde. Et s'il décide de sortir quand même la X5, bizarrement, il laisse traverser les piétons, respecte la priorité de droite et roule aussi lentement que la vieille Twingo derrière lui.
L'entreprise, elle, lutte à la fois contre une attaque terroriste et une grève générale: d'un côté, c'est plans d'urgence dans tous les sens pour assurer l'approvisionnement (quel qu'il soit) et faire tourner la boîte avec moitié moins de personnel, de l'autre, communications en tous genres pour convaincre les travailleurs que 30 cm de neige et 4 heures de bouchons, c'est pas une raison valable de pas venir au turbin.
Et malgré tout: les camions sont bloqués, y'a plus rien à acheter, les gens préfèrent rester chez eux. Résultat, la consommation baisse en pleine période de Noël.
J'aime bien la neige parce qu'elle réalise les cauchemars de ce monde de merde, sans fournir personne sur qui cogner à la police.
Tout tourne au ralenti, les avions sont cloués au sol, les bagnoles restent au garage, sans parler des trains et des camions. Les gens bossent moins (ou moins de gens bossent), et achètent moins. Ils passent du temps chez eux, et en plus les paysages sont jolis.
Finalement, la neige, c'est la nature qui fait de la désobéissance civile. C'est le monde qui se réenchante tout seul.
jeudi 23 décembre 2010
Il neige
J'ai pris congé ce matin. Quand je suis sorti de mon lit à une heure que seuls les étudiants trouvent matinale, j'ai vu qu'il avait neigé dehors. Je me suis fait deux tartines et une bonne tasse de thé, que je suis allé déguster en regardant le manteau blanc du cliché recouvrir mon paysage quotidien d'un je-ne-sais-quoi de poétique et vaguement jovial.
Et là, en peignoir, sur mon balcon, à l'abri des gens qui bossent, je me laisse porter par une rêverie un peu métaphysique. Tant mieux, j'ai rien d'autre à foutre.
Je pense à ce qu'on dû ressentir les premiers hommes devant un paysage enneigé. Au silence respectueux qu'ils ont dû avoir devant le spectacle d'une Belgique sans immeubles et sans autoroutes éclairées la nuit recouverte de neige à perte de vue.
On nous raconte souvent que nos ancêtre homo sapiens, sortes de créatures mi-singes mi-nègres, ont inventé le surnaturel à cause de la crainte que la nature hostile inspirait à leurs esprits pas encore entrés dans l'histoire.
Le connard à lunettes qui a pondu une connerie pareille n'a sans doute jamais pris le temps de regarder la neige en respirant le froid qui l'accompagne.
Je crois au contraire que le surnaturel est né dans un moment de silence, un de ces moments où l'homme est touché par la nature au-delà des mots. Comme un dialogue silencieux, à mi-chemin entre l'exaltation et le recueillement, une chanson muette qui le touche sans qu'il puisse dire comment.
Je crois que l'homme s'est inventé des dieux parce que parfois, la nature lui fait prendre conscience de son humanité d'une manière que la poésie et la musique ne font qu'imiter
J'aurais dû prendre la journée.
Et là, en peignoir, sur mon balcon, à l'abri des gens qui bossent, je me laisse porter par une rêverie un peu métaphysique. Tant mieux, j'ai rien d'autre à foutre.
Je pense à ce qu'on dû ressentir les premiers hommes devant un paysage enneigé. Au silence respectueux qu'ils ont dû avoir devant le spectacle d'une Belgique sans immeubles et sans autoroutes éclairées la nuit recouverte de neige à perte de vue.
On nous raconte souvent que nos ancêtre homo sapiens, sortes de créatures mi-singes mi-nègres, ont inventé le surnaturel à cause de la crainte que la nature hostile inspirait à leurs esprits pas encore entrés dans l'histoire.
Le connard à lunettes qui a pondu une connerie pareille n'a sans doute jamais pris le temps de regarder la neige en respirant le froid qui l'accompagne.
Je crois au contraire que le surnaturel est né dans un moment de silence, un de ces moments où l'homme est touché par la nature au-delà des mots. Comme un dialogue silencieux, à mi-chemin entre l'exaltation et le recueillement, une chanson muette qui le touche sans qu'il puisse dire comment.
Je crois que l'homme s'est inventé des dieux parce que parfois, la nature lui fait prendre conscience de son humanité d'une manière que la poésie et la musique ne font qu'imiter
J'aurais dû prendre la journée.
Inscription à :
Articles (Atom)