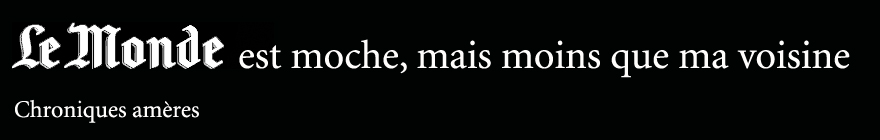Le mois de décembre est étouffant à Copa Cabana Beach Bay. Ici, je profite de la chaleur brûlante de l’été de l’hémisphère sud. Paresseusement allongé sur mon transat, j’émerge d’une sieste interminable en plein soleil. Combien de temps ai-je dormi ? Impossible à dire, parce que le soleil a fait perler une épaisse condensation sur le cadran de ma Festina de fabrication asiatique, pourtant présentée comme étanche. A en juger la position de l’astre, il doit être 15 heures. Je me serais donc assoupi trois bonnes heures. Sur mon torse extrêmement bronzé ruissellent des torrents de transpiration qui dévalent le long des sillons de mes abdominaux saillants, avant de s’échouer sur la cordelette de mon short en coton équitable.
Lorsque je lève les yeux, malgré les reflets aveuglants qui inondent la surface de l’eau, je devine derrière mes Ray Ban la silhouette sculpturale de Felindra. Nue comme un ver, elle sort délicatement de la piscine et se dirige vers le bar à cocktails, magistral ouvrage réalisé dans une essence de bambou local qui dégage un parfum boisé un peu trop pénétrant. Les seins pleins et gonflés de vie de la créature dansent la lambada au rythme de ses pas sur son torse cuivré et luisant. Les traces humides laissées sur les planches de la terrasse en teck s’évaporent aussitôt que ses pieds quittent le sol. Ce soleil frappe tellement fort que même l’ombre de son corps parfait dégouline de sueur. Lorsqu’elle se faufile à ma hauteur et croise mon regard, je détecte dans ses yeux tout le respect et la reconnaissance de celle qui peine encore à se remettre d’une nuit au cours de laquelle elle a exploré des territoires inconnus que ses cours d’anatomie avaient passés sous silence. Coquine. Et toujours ces effluves boisés de plus en plus présents.
Lorsque Felindra revient du bar, je m’extirpe difficilement du transat. La peau du dos, striée de marques rouges, fait un bruit de velcro quand elle se décolle du dossier en PVC blanc. Elle me tend un seau en inox Laurent Perrier, duquel elle sort un glaçon qu’elle promène le long de mes lèvres sèches pour m’humecter la bouche. Les souvenirs de la nuit précédente se précisent. Elle me présente ensuite un mojito servi dans un verre grand comme un lavabo, garni d’un petit parasol en papier et accompagne son geste de quelques charabias incompréhensibles, sans doute du Mandarin, prononcés avec un fort accent marseillais. « Mouyamé » que je me surprends à lui répondre. « Mouyamé, ma chérie. » Lorsque je goûte le breuvage pour me rafraîchir, je lui trouve un goût de pastis. Je repose les fesses sur la chaise longue, non sans avoir d’abord caressé les siennes, et m’allonge de nouveau, savourant le repos du guerrier en scrutant le ciel : pas un nuage, pas un centimètre carré d’ombre sur cette terre paradisiaque. Je me sens comme un calippo prisonnier de son plein gré d’un hammam à l'air libre. Je déguste. L’odeur de bois brûlé s’échappant du bar en bambou m’attaque les narines. J’en tombe à la renverse. Le téléphone sonne. "Allo ? Felindra ?" Personne. Le téléphone sonne toujours. Je bouscule le rocking chair, piétine la couverture qui reposait sur mes genoux flétris. Le parlophone. "Allo ? Felindra ? Qui ? Ah bonjour maman. Quoi ? Déjà ?" Et merde, ma dinde ! Et toujours cette odeur de brûlé...
Je hais Noël. Noël pas mouyamé.
vendredi 24 décembre 2010
Joyeux bordel
D'ici deux mois, je râlerai sans doute comme le reste de mes concitoyens, mais pour l'instant, j'aime bien la neige. Pas seulement pour la beauté douceâtre des paysages immaculés, qui évoque des odeurs de chocolat chaud et de cougnou, et permet au premier fonctionnaire venu de philosopher à moindres frais. Non. En fait, j'aime surtout la neige pour cette façon tranquille, poétique et implacable qu'elle a de foutre le bordel partout.
J'aime bien la neige, parce qu'elle n'épargne personne: un bordel à ce point intégral, il est tellement égalitaire qu'il en devient presque politique.
Quand toutes les routes sont bloquées ou verglassées, le gros manager vient au boulot en train, comme la petite stagiaire, et dans le train, il se bat pour un coin de banquette, comme tout le monde. Et s'il décide de sortir quand même la X5, bizarrement, il laisse traverser les piétons, respecte la priorité de droite et roule aussi lentement que la vieille Twingo derrière lui.
L'entreprise, elle, lutte à la fois contre une attaque terroriste et une grève générale: d'un côté, c'est plans d'urgence dans tous les sens pour assurer l'approvisionnement (quel qu'il soit) et faire tourner la boîte avec moitié moins de personnel, de l'autre, communications en tous genres pour convaincre les travailleurs que 30 cm de neige et 4 heures de bouchons, c'est pas une raison valable de pas venir au turbin.
Et malgré tout: les camions sont bloqués, y'a plus rien à acheter, les gens préfèrent rester chez eux. Résultat, la consommation baisse en pleine période de Noël.
J'aime bien la neige parce qu'elle réalise les cauchemars de ce monde de merde, sans fournir personne sur qui cogner à la police.
Tout tourne au ralenti, les avions sont cloués au sol, les bagnoles restent au garage, sans parler des trains et des camions. Les gens bossent moins (ou moins de gens bossent), et achètent moins. Ils passent du temps chez eux, et en plus les paysages sont jolis.
Finalement, la neige, c'est la nature qui fait de la désobéissance civile. C'est le monde qui se réenchante tout seul.
J'aime bien la neige, parce qu'elle n'épargne personne: un bordel à ce point intégral, il est tellement égalitaire qu'il en devient presque politique.
Quand toutes les routes sont bloquées ou verglassées, le gros manager vient au boulot en train, comme la petite stagiaire, et dans le train, il se bat pour un coin de banquette, comme tout le monde. Et s'il décide de sortir quand même la X5, bizarrement, il laisse traverser les piétons, respecte la priorité de droite et roule aussi lentement que la vieille Twingo derrière lui.
L'entreprise, elle, lutte à la fois contre une attaque terroriste et une grève générale: d'un côté, c'est plans d'urgence dans tous les sens pour assurer l'approvisionnement (quel qu'il soit) et faire tourner la boîte avec moitié moins de personnel, de l'autre, communications en tous genres pour convaincre les travailleurs que 30 cm de neige et 4 heures de bouchons, c'est pas une raison valable de pas venir au turbin.
Et malgré tout: les camions sont bloqués, y'a plus rien à acheter, les gens préfèrent rester chez eux. Résultat, la consommation baisse en pleine période de Noël.
J'aime bien la neige parce qu'elle réalise les cauchemars de ce monde de merde, sans fournir personne sur qui cogner à la police.
Tout tourne au ralenti, les avions sont cloués au sol, les bagnoles restent au garage, sans parler des trains et des camions. Les gens bossent moins (ou moins de gens bossent), et achètent moins. Ils passent du temps chez eux, et en plus les paysages sont jolis.
Finalement, la neige, c'est la nature qui fait de la désobéissance civile. C'est le monde qui se réenchante tout seul.
jeudi 23 décembre 2010
Il neige
J'ai pris congé ce matin. Quand je suis sorti de mon lit à une heure que seuls les étudiants trouvent matinale, j'ai vu qu'il avait neigé dehors. Je me suis fait deux tartines et une bonne tasse de thé, que je suis allé déguster en regardant le manteau blanc du cliché recouvrir mon paysage quotidien d'un je-ne-sais-quoi de poétique et vaguement jovial.
Et là, en peignoir, sur mon balcon, à l'abri des gens qui bossent, je me laisse porter par une rêverie un peu métaphysique. Tant mieux, j'ai rien d'autre à foutre.
Je pense à ce qu'on dû ressentir les premiers hommes devant un paysage enneigé. Au silence respectueux qu'ils ont dû avoir devant le spectacle d'une Belgique sans immeubles et sans autoroutes éclairées la nuit recouverte de neige à perte de vue.
On nous raconte souvent que nos ancêtre homo sapiens, sortes de créatures mi-singes mi-nègres, ont inventé le surnaturel à cause de la crainte que la nature hostile inspirait à leurs esprits pas encore entrés dans l'histoire.
Le connard à lunettes qui a pondu une connerie pareille n'a sans doute jamais pris le temps de regarder la neige en respirant le froid qui l'accompagne.
Je crois au contraire que le surnaturel est né dans un moment de silence, un de ces moments où l'homme est touché par la nature au-delà des mots. Comme un dialogue silencieux, à mi-chemin entre l'exaltation et le recueillement, une chanson muette qui le touche sans qu'il puisse dire comment.
Je crois que l'homme s'est inventé des dieux parce que parfois, la nature lui fait prendre conscience de son humanité d'une manière que la poésie et la musique ne font qu'imiter
J'aurais dû prendre la journée.
Et là, en peignoir, sur mon balcon, à l'abri des gens qui bossent, je me laisse porter par une rêverie un peu métaphysique. Tant mieux, j'ai rien d'autre à foutre.
Je pense à ce qu'on dû ressentir les premiers hommes devant un paysage enneigé. Au silence respectueux qu'ils ont dû avoir devant le spectacle d'une Belgique sans immeubles et sans autoroutes éclairées la nuit recouverte de neige à perte de vue.
On nous raconte souvent que nos ancêtre homo sapiens, sortes de créatures mi-singes mi-nègres, ont inventé le surnaturel à cause de la crainte que la nature hostile inspirait à leurs esprits pas encore entrés dans l'histoire.
Le connard à lunettes qui a pondu une connerie pareille n'a sans doute jamais pris le temps de regarder la neige en respirant le froid qui l'accompagne.
Je crois au contraire que le surnaturel est né dans un moment de silence, un de ces moments où l'homme est touché par la nature au-delà des mots. Comme un dialogue silencieux, à mi-chemin entre l'exaltation et le recueillement, une chanson muette qui le touche sans qu'il puisse dire comment.
Je crois que l'homme s'est inventé des dieux parce que parfois, la nature lui fait prendre conscience de son humanité d'une manière que la poésie et la musique ne font qu'imiter
J'aurais dû prendre la journée.
mardi 30 novembre 2010
Thèse, antithèse, foutaises
J'en peux plus. J'ai beau essayer, j'en peux plus. J'en ai ma claque des conversations absurdes dans lesquelles je passe au mieux pour un doux rêveur, au pire pour un imbécile naïf.
J'en ai ras la casquette de m'entendre sortir l'argument de la liberté de choix par des gens trop paresseux pour penser un autre mode de vie, ou trop mous du genou pour oser en changer.
Je vais pas retaper ici la litanie d'arguments écologiques, économiques, sociaux, sanitaires et j'en passe qui montrent que ce système va dans le mur, s'il n'y est pas déjà. Ça m'énerve aussi, mais aujourd'hui c'est à des personnes hypocrites et à leurs stratégies d'évitement médiocres que j'en ai.
Discutez ne fut-ce qu'une minute de la nécessité de repenser la mobilité et remettre en question le tout à la bagnole, vous aurez droit à un festival de sophismes idiots, de cache-sexes rhétoriques destinés à masquer le refus atavique de menacer, même un tout petit peu, son confort personnel, fut-ce améliorer le sort de l'Humanité ou simplement préserver l'avenir ses propres enfants. Quand je vois la bassesse à laquelle mes concitoyens sont prêts à recourir pour préserver leur droit de bouffer des fraises toute l'année, franchement, ça me fait gerber.
L'avatar le plus minable de cette rhétorique de caniveau, c'est l'argument politique. Rien que de l'écrire j'ai envie de coller des beignes. Les mêmes personnes qui lisent la DH en crachant sur la caste politique, au cri de "tous pourris", soutiennent sans rougir que pour que les habitudes (alimentation, bagnoles, avion, j'en passe) changent, il faut que l'exemple vienne "d'en haut". Et "en haut" c'est qui? En haut c'est tous pourris.
A peine moins pire, l'argument du puriste: si tu n'as pas une alternative irréprochable à offrir, pas la peine d'espérer convaincre ton auditoire. En gros, si t'es pas Jésus, c'est déjà perdu. Et donc, après avoir expliqué de façon rationnelle, parfois même chiffres à l'appui, que l'agriculture industrielle c'est une saloperie sans nom, on te répondra sans rougir que oui mais dans le bio, y'a aussi des additifs qui sont autorisés et que de toute façon, la filière est pas fiable et y'a des magouilles et bla et bla et bla. Donc puisque certains additifs sont autorisés en bio, le bio et le MacDo, c'est kif. Pareil pour la certification: puisque l'attribution du label peut parfois être mise en cause, les producteurs bio ne valent finalement pas mieux que Carrefour qui réassortit ses rayons avec de la bidoche faisandée.
Troisième tactique: décrédibiliser les alternatives par la caricature, avec le désormais culte "le bio, c'est vouloir s'éclairer à la bougie et se chauffer au charbon". Très courant chez ceux qui n'ont pas peur de clore la discussion en restant fâchés. Typique d'un besoin de réduire les questions de société à une opposition manichéenne, mais surtout retraite confortable pour les esprits paresseux qui peuvent dès lors entendre tous les maux engendrés par notre modèle de société - déforestation, changements climatiques, je refais pas la liste - sans se faire de mouron, vu que de toutes façons, c'est ça ou "s'éclairer à la bougie".
Bref, il faut que les politiques, qui sont tous pourris, montrent l'exemple et mettent en place des alternatives irréprochables, vierges de tout soupçon de corruption, tout prenant garde de ne rien changer à nos habitudes, parce que bon, pas question de s'éclairer à la bougie hein. Et pendant ce temps-là les réserves d'eau s'épuisent, les terres cultivables s'appauvrissent et les téléphones portables sont devenus l'étalon de mesure du progrès.
Ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, c'est que ceux qui ne veulent rien entendre, même quand on évoque que leurs enfants -et souvent ils en ont - auront à payer le prix de leurs refus, sont les mêmes qui vont faire le pied de grue devant les écoles élitistes et se battent contre le décret mixité.
Au nom de l'avenir de leurs mômes.
J'en ai ras la casquette de m'entendre sortir l'argument de la liberté de choix par des gens trop paresseux pour penser un autre mode de vie, ou trop mous du genou pour oser en changer.
Je vais pas retaper ici la litanie d'arguments écologiques, économiques, sociaux, sanitaires et j'en passe qui montrent que ce système va dans le mur, s'il n'y est pas déjà. Ça m'énerve aussi, mais aujourd'hui c'est à des personnes hypocrites et à leurs stratégies d'évitement médiocres que j'en ai.
Discutez ne fut-ce qu'une minute de la nécessité de repenser la mobilité et remettre en question le tout à la bagnole, vous aurez droit à un festival de sophismes idiots, de cache-sexes rhétoriques destinés à masquer le refus atavique de menacer, même un tout petit peu, son confort personnel, fut-ce améliorer le sort de l'Humanité ou simplement préserver l'avenir ses propres enfants. Quand je vois la bassesse à laquelle mes concitoyens sont prêts à recourir pour préserver leur droit de bouffer des fraises toute l'année, franchement, ça me fait gerber.
L'avatar le plus minable de cette rhétorique de caniveau, c'est l'argument politique. Rien que de l'écrire j'ai envie de coller des beignes. Les mêmes personnes qui lisent la DH en crachant sur la caste politique, au cri de "tous pourris", soutiennent sans rougir que pour que les habitudes (alimentation, bagnoles, avion, j'en passe) changent, il faut que l'exemple vienne "d'en haut". Et "en haut" c'est qui? En haut c'est tous pourris.
A peine moins pire, l'argument du puriste: si tu n'as pas une alternative irréprochable à offrir, pas la peine d'espérer convaincre ton auditoire. En gros, si t'es pas Jésus, c'est déjà perdu. Et donc, après avoir expliqué de façon rationnelle, parfois même chiffres à l'appui, que l'agriculture industrielle c'est une saloperie sans nom, on te répondra sans rougir que oui mais dans le bio, y'a aussi des additifs qui sont autorisés et que de toute façon, la filière est pas fiable et y'a des magouilles et bla et bla et bla. Donc puisque certains additifs sont autorisés en bio, le bio et le MacDo, c'est kif. Pareil pour la certification: puisque l'attribution du label peut parfois être mise en cause, les producteurs bio ne valent finalement pas mieux que Carrefour qui réassortit ses rayons avec de la bidoche faisandée.
Troisième tactique: décrédibiliser les alternatives par la caricature, avec le désormais culte "le bio, c'est vouloir s'éclairer à la bougie et se chauffer au charbon". Très courant chez ceux qui n'ont pas peur de clore la discussion en restant fâchés. Typique d'un besoin de réduire les questions de société à une opposition manichéenne, mais surtout retraite confortable pour les esprits paresseux qui peuvent dès lors entendre tous les maux engendrés par notre modèle de société - déforestation, changements climatiques, je refais pas la liste - sans se faire de mouron, vu que de toutes façons, c'est ça ou "s'éclairer à la bougie".
Bref, il faut que les politiques, qui sont tous pourris, montrent l'exemple et mettent en place des alternatives irréprochables, vierges de tout soupçon de corruption, tout prenant garde de ne rien changer à nos habitudes, parce que bon, pas question de s'éclairer à la bougie hein. Et pendant ce temps-là les réserves d'eau s'épuisent, les terres cultivables s'appauvrissent et les téléphones portables sont devenus l'étalon de mesure du progrès.
Ce qui me dégoûte le plus dans tout ça, c'est que ceux qui ne veulent rien entendre, même quand on évoque que leurs enfants -et souvent ils en ont - auront à payer le prix de leurs refus, sont les mêmes qui vont faire le pied de grue devant les écoles élitistes et se battent contre le décret mixité.
Au nom de l'avenir de leurs mômes.
samedi 30 octobre 2010
Garçon, une Chimay, une Léberg pétillante et un Parasol orange
Avez-vous remarqué comme il est devenu difficile de trouver un bon bistrot? Je veux dire un vrai bistrot, avec des banquettes en skaï toutes pourries et des chaises pas confortables, un troquet dans lequel la portion de gouda jeune a eu le temps de tourner mi-vieux, un estaminet où l'on vous nettoie la table avec une lavette qui sent la vieille eau de vaisselle, bref un authentique caberdouche tout-pourri.
Je ne dirai jamais assez de mal des connards qui ont repris des endroits géniaux qu'ils ont dénaturés, parfois sous prétexte de les sauver.
Le jour où je croise une raclure qui se vante devant moi d'avoir ouvert un de ces horribles commerces décorés n'importe comment sous prétexte d'originalité, qui te vend de l'eau pétillante du Nicaragua à 8 euros le verre, sous un éclairage mauve-fuschia, le jour - donc - où je croise un type pareil sans ses pitbulls et ses gardes du corps, il se prend illico un coup de pied dans les couilles, genre fallait pas laisser Nilis tout seul devant le but.
Au sommet de ma liste des reprises de volée casse-burnes, je place sans hésitation: Le Botanique à Bruxelles. Je me souviens d'une cafétaria dont le sandwich le plus exotique était à la salade de viande, doublée d'un resto qui servait invariablement du poulet sauce au poivre, un comptoir où Madame Capuccino venait commander son faux capuccino qu'elle allait boire sous l'escalier en bois. Un endroit qui, les soirs de concert, se transformait en l'un des derniers bars rock de la ville, dans l'esprit comme dans le son. J'y ai vu le barman jeter dehors des types moins saouls que lui au son des Stooges ou des Pixies. J'y ai aussi vu Arno, ivre mort commander une vodka en marmonnant et Catherine Ringer des Rita se donner en spectacle sur l'escalier de Madame Capuccino, pendant que Mano Solo se roulait un pétard à l'endroit-même où elle était assise plus tôt dans la journée.
Aujourd'hui, cet endroit est devenu un "café dansant". Il n'y a plus d'escalier en bois sous lequel boire son mauvais café. Le resto a été fermé pour agrandir la piste de danse et les chaises en métal hideuses remplacées par des divans. Le soir, à la place des Stooges, on peut entendre deux idiots derrière leurs platines se prendre pour les frères Dewaele. C'est une horreur, n'y allez jamais.
Dans un autre registre, on a les bars "de caractère". Genre: on va rénover le bazar sans détruire son charme. Des couilles, oui: le résultat est invariablement un nouvel avatar du bar tendance, dont la pire incarnation est le faux estaminet, genre le Verschueren (à Bruxelles toujours). L'intérieur en bois est préservé, le mobilier rafraîchi, mais sans dénoter. On a même droit aux panneaux publicitaires métalliques vintage qu'on trouve dans un kot étudiant sur deux. Bref, une atmosphère old school à souhait, dans le respect du paysage urbain et du patrimoine bruxellois. Sauf que...la serveuse sait à peine servir une Chimay, le potage du jour est un truc végétarien de saison, type potage aux lentilles (sans lard) et que t'as beau chercher tant que tu veux, y'a pas un seul vieux du quartier accoudé au bar; t'as beau regarder dans tous les coins, y'a pas de bingo; et si tu veux une eau pétillante, tu dois choisir entre trois trucs différents.
Un jour, j'ouvrirai un café, un vrai bistrot digne de ce nom. Un troquet avec les banquettes en skaï et les chaises inconfortables. Les tables seront branlantes et tiendront avec une pile de sous bocks grosse comme un bottin. J'y servirai du faux capuccino, celui avec la chantilly à la bombe qui arrache une grimace de mépris aux serveuses de latte authentique de chez Starbucks. Qu'elles aillent se faire foutre: je servirai du faux capuccino mais du vrai Irish Coffee.
Si j'engage une serveuse, elle sera moche, mais elle connaîtra toutes les bières de la carte, qu'elle saura servir les yeux fermés en chantonnant Led Zep. Elle se frottera les mains sur son t-shirt Frank Black avant de couper une portion de fromage pas bio, pas cher et pas frais, qu'elle servira avec de la moutarde du Colruyt dans un pot Amora.
Il y aura un bingo, à côté de la porte des toilettes; toilettes qui, sans être véritablement sales, ne seront pas vraiment propres non plus.
La carte, minime, sera conçue pour déprimer le connard cosmopolite et sa pouffiasse en quête d'endroits authentiques pour siroter un Gini ou une "San Pe". Déjà, y'aura pas de "San Pe", ni de Gini, ni de Fanta, de Sprite ou même de Chaudfontaine: chez moi Monsieur, on boira de la Léberg et du Parasol orange.
Mon troquet, ce sera l'archétype du café du coin. Un endroit où on vient boire un verre le dimanche après avoir acheté son poulet rôti au marché. L'endroit où le vieux raciste peut côtoyer l'ouvrier arabe. La plaque tournante de la philosophie et de la politique de comptoir.
Mon troquet, ce sera pas un commerce destiné à divertir la classe moyenne.
Ce sera un morceau de ville rendu à la classe populaire.
Et un doigt d'honneur à une politique qui ne voit de patrimoine que dans les vieux bâtiments, les défilés costumés, et les bières d'abbayes. Sans voir que le vrai patrimoine culturel réside dans la façon qu'a un vieux poivrot de boire sa Chimay, refaisant le monde en patois, accoudé à un zinc pas propre.
C'est vraiment de plus en plus dur de trouver un bon bistrot.
Je ne dirai jamais assez de mal des connards qui ont repris des endroits géniaux qu'ils ont dénaturés, parfois sous prétexte de les sauver.
Le jour où je croise une raclure qui se vante devant moi d'avoir ouvert un de ces horribles commerces décorés n'importe comment sous prétexte d'originalité, qui te vend de l'eau pétillante du Nicaragua à 8 euros le verre, sous un éclairage mauve-fuschia, le jour - donc - où je croise un type pareil sans ses pitbulls et ses gardes du corps, il se prend illico un coup de pied dans les couilles, genre fallait pas laisser Nilis tout seul devant le but.
Au sommet de ma liste des reprises de volée casse-burnes, je place sans hésitation: Le Botanique à Bruxelles. Je me souviens d'une cafétaria dont le sandwich le plus exotique était à la salade de viande, doublée d'un resto qui servait invariablement du poulet sauce au poivre, un comptoir où Madame Capuccino venait commander son faux capuccino qu'elle allait boire sous l'escalier en bois. Un endroit qui, les soirs de concert, se transformait en l'un des derniers bars rock de la ville, dans l'esprit comme dans le son. J'y ai vu le barman jeter dehors des types moins saouls que lui au son des Stooges ou des Pixies. J'y ai aussi vu Arno, ivre mort commander une vodka en marmonnant et Catherine Ringer des Rita se donner en spectacle sur l'escalier de Madame Capuccino, pendant que Mano Solo se roulait un pétard à l'endroit-même où elle était assise plus tôt dans la journée.
Aujourd'hui, cet endroit est devenu un "café dansant". Il n'y a plus d'escalier en bois sous lequel boire son mauvais café. Le resto a été fermé pour agrandir la piste de danse et les chaises en métal hideuses remplacées par des divans. Le soir, à la place des Stooges, on peut entendre deux idiots derrière leurs platines se prendre pour les frères Dewaele. C'est une horreur, n'y allez jamais.
Dans un autre registre, on a les bars "de caractère". Genre: on va rénover le bazar sans détruire son charme. Des couilles, oui: le résultat est invariablement un nouvel avatar du bar tendance, dont la pire incarnation est le faux estaminet, genre le Verschueren (à Bruxelles toujours). L'intérieur en bois est préservé, le mobilier rafraîchi, mais sans dénoter. On a même droit aux panneaux publicitaires métalliques vintage qu'on trouve dans un kot étudiant sur deux. Bref, une atmosphère old school à souhait, dans le respect du paysage urbain et du patrimoine bruxellois. Sauf que...la serveuse sait à peine servir une Chimay, le potage du jour est un truc végétarien de saison, type potage aux lentilles (sans lard) et que t'as beau chercher tant que tu veux, y'a pas un seul vieux du quartier accoudé au bar; t'as beau regarder dans tous les coins, y'a pas de bingo; et si tu veux une eau pétillante, tu dois choisir entre trois trucs différents.
Un jour, j'ouvrirai un café, un vrai bistrot digne de ce nom. Un troquet avec les banquettes en skaï et les chaises inconfortables. Les tables seront branlantes et tiendront avec une pile de sous bocks grosse comme un bottin. J'y servirai du faux capuccino, celui avec la chantilly à la bombe qui arrache une grimace de mépris aux serveuses de latte authentique de chez Starbucks. Qu'elles aillent se faire foutre: je servirai du faux capuccino mais du vrai Irish Coffee.
Si j'engage une serveuse, elle sera moche, mais elle connaîtra toutes les bières de la carte, qu'elle saura servir les yeux fermés en chantonnant Led Zep. Elle se frottera les mains sur son t-shirt Frank Black avant de couper une portion de fromage pas bio, pas cher et pas frais, qu'elle servira avec de la moutarde du Colruyt dans un pot Amora.
Il y aura un bingo, à côté de la porte des toilettes; toilettes qui, sans être véritablement sales, ne seront pas vraiment propres non plus.
La carte, minime, sera conçue pour déprimer le connard cosmopolite et sa pouffiasse en quête d'endroits authentiques pour siroter un Gini ou une "San Pe". Déjà, y'aura pas de "San Pe", ni de Gini, ni de Fanta, de Sprite ou même de Chaudfontaine: chez moi Monsieur, on boira de la Léberg et du Parasol orange.
Mon troquet, ce sera l'archétype du café du coin. Un endroit où on vient boire un verre le dimanche après avoir acheté son poulet rôti au marché. L'endroit où le vieux raciste peut côtoyer l'ouvrier arabe. La plaque tournante de la philosophie et de la politique de comptoir.
Mon troquet, ce sera pas un commerce destiné à divertir la classe moyenne.
Ce sera un morceau de ville rendu à la classe populaire.
Et un doigt d'honneur à une politique qui ne voit de patrimoine que dans les vieux bâtiments, les défilés costumés, et les bières d'abbayes. Sans voir que le vrai patrimoine culturel réside dans la façon qu'a un vieux poivrot de boire sa Chimay, refaisant le monde en patois, accoudé à un zinc pas propre.
C'est vraiment de plus en plus dur de trouver un bon bistrot.
Inscription à :
Articles (Atom)